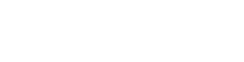Les Congolais font le triste constat d’une arène politique théâtrale où les invectives et la critique acerbe des opposants leur tiennent lieu de programmes. L’opposition politique en République Démocratique du Congo se caractérise par une posture de dénonciation stérile mais peine à proposer des alternatives sectorielles constructives. Cette tendance, bien qu’ayant des racines historiques, semble s’être accentuée ces dernières années, laissant un vide dans le débat public
Une tradition de dénonciation
L’opposition congolaise naît véritablement sous la dictature de Mobutu Sese Seko (1965–1997). Dans un État où le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) règne en parti unique, la contestation est périlleuse. Étienne Tshisekedi, fondateur de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), incarne la résistance politique et morale. Il défie Mobutu, dénonçant la corruption, la mauvaise gouvernance et les violations des droits. D’autres figures émergent, comme Frédéric Kibassa Maliba ou Cléophas Kamitatu, mais c’est surtout l’UDPS qui structure le discours de contestation et mène la lutte pour les droits fondamentaux et la démocratie. L’opposition, souvent exilée ou bâillonnée, ne peut proposer de réformes de fond. Elle joue un rôle symbolique, appelant au pluralisme et à l’alternance démocratique dans un climat de mainmise politique totale. La libéralisation politique et le multipartisme apparaissent progressivement à partir de 1990, avec la fin des blocs et les débuts de la mondialisation.
Avec l’accession au pouvoir de Joseph Kabila (2001–2019), l’espace politique s’ouvre, mais demeure sous contrôle. L’opposition devient très médiatique avec les développements de la communication numérique et la libéralisation des médias, mais elle reste divisée. L’opposition de l’ère Kabila est grande partie tournée vers la dénonciation des fraudes électorales, de la corruption et de la violence d’État. Les propositions de l’opposition sur la réforme de la justice, la relance économique ou la stabilisation du pays sont peu cadrées. Les réformes sectorielles sont soutenues par les partenaires financiers de la RDC et imposées avec l’avec l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba. La dénonciation des irrégularités électorales et de la corruption a éclipsé l’élaboration de visions sectorielles alternatives.
Sous Kabila les principales figures de l’opposition sont incarnées par Étienne Tshisekedi avec l’UDPS qui poursuit le combat mené depuis l’époque de Mobutu Sese Seko, avec la même verve oratoire il conteste les résultats des élections de 2011. Son décès en 2017 a laissé un vide dans l’arène politique, vite comblé par son fils Félix Tshisekedi qui a pris le relais. Jean-Pierre Bemba Gombo (Mouvement de Libération du Congo – MLC), qui fut l’un des quatre vice-présidents pendant la période de transition (2003-2006) affronte Joseph Kabila au second tour et devient le chef de file de l’opposition après sa défaite.
Incarcéré par la Cour Pénale Internationale (CPI) en 2008, puis acquitté en 2018, Bemba a su réaliser un retour spectaculaire sur la scène politique. Moïse Katumbi, l’ancien gouverneur du Katanga et allié de Joseph Kabila a rompu avec son régime en 2015, rejoignant les rangs de l’opposition et devenant l’une des figures majeures de la contestation, notamment en vue de l’élection présidentielle de 2018. Il a fait face à des poursuites judiciaires qui l’ont contraint à l’exil pendant plusieurs années. Vital Kamerhe (Union pour la Nation Congolaise – UNC), ancien Président de l’Assemblée Nationale sous Kabila s’en est éloigné et a créé son propre parti d’opposition, l’UNC. Il fut directeur de campagne de Félix Tshisekedi en 2018. Franck Diongo (Mouvement Lumumbiste Progressiste – MLP) s’est distingué comme figure majeure de l’opposition par ses critiques virulentes du régime de Kabila. Martin Fayulu (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement – ECiDé / Coalition Lamuka) a gagné en visibilité vers la fin du mandat de Kabila et fut le candidat commun d’une partie importante de l’opposition sous la bannière de la coalition Lamuka lors des élections de 2018, dont il a contesté les résultats officiels. La période Kabila se caractérise aussi par l’apparition des Mouvements citoyens (Lucha, Filimbi) animés par des jeunes activistes qui ont joué un rôle important dans la contestation de la prolongation du mandat de Kabila, par des manifestations et des actions de désobéissance civile.
Sous Félix Tshisekedi une opposition toujours contestataire
Sous la présidence de Félix Tshisekedi le style contestataire de l’opposition congolaise perdure sans créativité politique. Des voix comme celles de Martin Fayulu, figé dans la contestation post-électorale, de Moïse Katumbi, dont les critiques restent souvent générales, ou d’Olivier Kamitatu, plus enclin à la communication qu’à la proposition, illustrent une opposition qui peine à se départir d’une posture réactive et négative. La période Tshisekedi qui est celle d’une démocratie affranchie des carcans militaro-sécuritaires des périodes Mobutu et Kabila révèle une opposition incapable de concevoir des alternatives sectorielles. Sur des dossiers aussi cruciaux que la sécurisation de l’Est, la relance économique, ou l’amélioration des systèmes de santé et d’éducation, les contre-propositions concrètes et étayées sont inexistantes. L’énergie des opposants semble davantage dépensée dans la diabolisation de l’adversaire que dans l’élaboration de plans d’action alternatifs. Quelles sont les visions économiques des opposants pour diversifier l’économie et créer des emplois durables ? Nul ne le sait. L’opposition est dans une logique de positionnement sans proposition.
Pourtant, une opposition constructive est vitale pour la santé démocratique d’une nation. Elle doit être une force de proposition, capable d’enrichir le débat public, d’offrir des choix clairs aux citoyens et de contribuer activement à la construction d’un avenir meilleur. En son temps, Etienne Tshisekedi a su proposer la démocratie comme modèle de gouvernement, à une époque très répressive où le verrouillage du Parti-Etat MPR sur l’économie et l’organisation sociale excluait toute forme de propositions sectorielles. Mais les opposants d’aujourd’hui se cantonnent à la critique systématique et aux attaques personnelles qui ne servent ni la cause de la démocratie ni les intérêts du peuple congolais. Il est impératif que l’opposition congolaise se régénère. Elle doit entamer une collaboration constructive avec le pouvoir, en proposant des programmes sectoriels crédibles.
Les opposants doivent discuter avec le pouvoir
L’histoire de l’opposition en RDC est riche en figures courageuses qui ont lutté pour la liberté et la démocratie. Il est temps, aujourd’hui, de passer à une nouvelle phase : celle d’une opposition capable de traduire ses critiques en solutions viables. En contraste à cette absence de contribution programmatique significative de l’opposition, le Président Félix Tshisekedi a quant à lui initié une dynamique de profondes réformes depuis son accession au pouvoir. On peut citer, parmi celles-ci, la mise en œuvre progressive de la gratuité de l’enseignement primaire et des efforts pour étendre la gratuité des accouchements, des mesures concrètes qui tentent de répondre aux besoins fondamentaux de la population, là où l’opposition peine à articuler des alternatives structurées. Sous sa présidence, le carcan sécuritaire de l’ANR s’est desserré et la mainmise des généraux dans les affaires politiques a disparu.
L’opposition congolaise ne connait pas ses missions. Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire électorale s’est enfermé dans un discours radical, refusant tout dialogue avec le pouvoir. On le voit pactiser avec Joseph Kabila dans une alliance de la carpe et du lapin. Moïse Katumbi, revenu d’exil, s’est installé dans la critique virulente et peine à quitter son statut d’ancien gouverneur du Katanga. Ni lui ni ses alliés n’ont présenté de programme politique sectoriel praticable depuis l’élection de Félix Tshisekedi. Olivier Kamitatu, bras droit de Katumbi, privilégie une communication incisive, mais jamais suivie de propositions concrètes. Cette opposition très critique ne présente pas d’alternatives claires. Sur des dossiers cruciaux comme l’insécurité dans l’est de la RDC, la réforme de la CENI, l’éducation ou la santé, l’opposition se limite trop souvent à critiquer les mesures du gouvernement en place sans formuler des solutions innovantes.
L’opposition congolaise est absente dès qu’il s’agit de produire de la réflexion et se contente de bavardages pompeux dans les médias sans rien proposer de constructif. Moise Katumbi ou Martin Fayulu se sont spécialisés dans des adresses télévisées théâtrales à la population au cours desquelles ils tiennent des propos irréels et fantomatiques. Particulièrement sur le plan économique, les opposants sont incapables de présenter des propositions détaillées sur la fiscalité, l’industrialisation ou le renouveau agricole. Une exception de taille émerge du lot, celle de l’ancien Premier ministre Adolphe Muzito toujours prêt au dialogue et qui a proposé aux Congolais un projet de société constructif, dans une série de tribunes chiffrées publiées sous la forme de livres accessibles et présentés lors d’universités populaires.
Les discours de l’opposition sous Félix Tshisekedi sont orientés vers la diabolisation et marqués par un manque criant de contre-propositions concrètes. Cette opposition oscille entre dénonciation permanente et carence programmatique. Le chemin vers une démocratie mature et un développement durable passe par la réalité d’une opposition constructive, non figée dans la négation systématique, mais engagée dans la recherche de l’intérêt général, en partenaire responsable. L’opposition congolaise doit saisir la main tendue de Félix Tshisekedi pour un gouvernement d’union nationale et apporter sa contribution à l’édifice national.
Léon ENGULU III
Philosophe